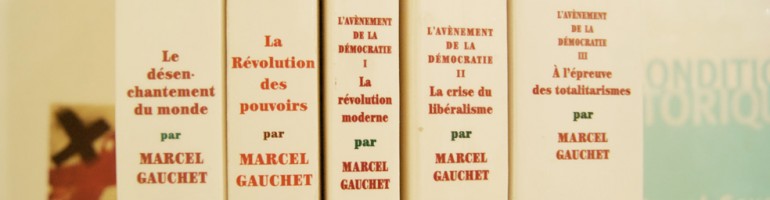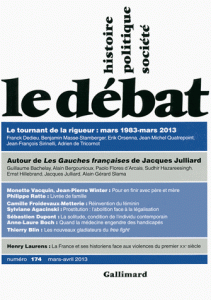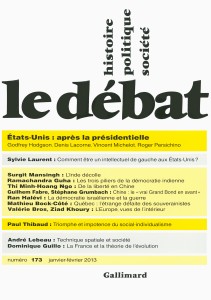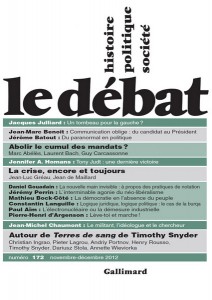SOMMAIRE
LE TOURNANT DE LA RIGUEUR : MARS 1983 – MARS 2013
Ce mois de mars 2013 marque un anniversaire qui ne sera guère commémoré : le trentième anniversaire du changement de politique économique décidé par le gouvernement de François Mitterrand en mars 1983, un peu moins de deux ans après l’alternance de 1981. Un changement de cap connu sous le nom de « tournant de la rigueur », bien que le mot ait été à l’époque soigneusement banni par ses initiateurs. Ses conséquences ont été telles qu’il est justifié d’y revenir et de l’examiner de près, d’autant que l’actualité semble nous ramener, trente ans après, dans des parages voisins.
L’événement a été entouré d’un peu de mystère et de beaucoup de légendes. Erik Orsenna, qui était alors conseiller à l’Élysée, apporte son témoignage sur le contexte du choix de Mitterrand. Le problème principal, derrière l’état des finances publiques, était en fait celui de la parité entre le franc et le mark dans le cadre du Système monétaire européen. Jean-Michel Quatrepoint reconstitue les données du problème et analyse les effets de la défaite française dans la bataille monétaire.
Le tournant est encore trop proche pour que les historiens aient pu véritablement s’en saisir. Jean-François Sirinelli interroge les voies et la manière dont ils pourraient l’aborder.
Et si nous reprenions le même chemin ‘ Certes, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve et les circonstances sont très différentes. Néanmoins il est difficile de se défendre du sentiment que l’histoire se répète, devant les orientations que le gouvernement de François Hollande est aujourd’hui amené à prendre. Franck Dedieu, Benjamin Masse-Stamberger et Adrien de Tricornot creusent le parallèle des situations et des stratégies. La comparaison a au moins pour vertu de faire ressortir les erreurs à éviter.
– Erik Orsenna, Le choix de François Mitterrand. Entretien
– Jean-Michel Quatrepoint, Mars 83 ou comment la France a perdu la guerre monétaire
– Jean-François Sirinelli, Quelques jours en mars
– Frank Dedieu, Benjamin Masse-Stamberger et Adrien de Tricornot, Mars 1983-mars 2013 : bis repetita ?