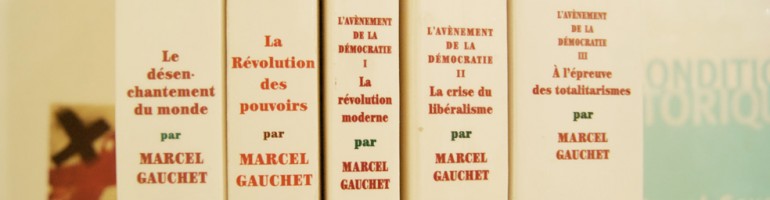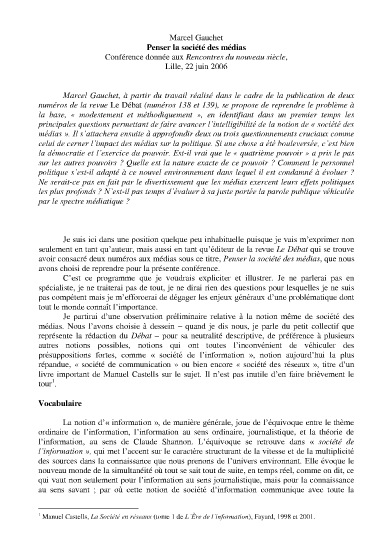Entretien publié dans Le Monde du 11 mars 2006.
Vous qui aviez décrit, dans les années 1980, la venue d’un monde « désenchanté », n’êtes-vous pas surpris par le retour brutal de la religion sur la scène politique internationale ?
Non. J’avais été étonné, comme tout le monde, par la révolution islamique en Iran, mais depuis, j’ai toujours pensé que nous n’étions pas au bout de nos surprises avec ce double mouvement paradoxal de la « sortie » de la religion, qui s’accélère en Occident – le cas des Etats-Unis étant atypique – et de la réactivation des identités religieuses dans le reste du monde, spécialement le monde islamique. J’insiste : ce n’est pas à un « retour » de la religion en bonne et due forme que nous assistons, mais à une reviviscence des identités à caractère religieux.
Le problème des Européens est qu’ils ne parviennent plus à comprendre ce que la religion veut dire dans des sociétés où elle garde une force très structurante. Ils ont oublié leur propre passé. Pour eux, la religion est devenue un système de croyances individuelles et privées. Or le reste du monde ne fonctionne pas ainsi. Il n’est pas épargné par la « sortie » de la religion, qui s’accélère, au contraire, avec la mondialisation. Mais cette « sortie » d’une organisation religieuse du monde, détruite par l’urbanisation, l’économisme de type occidental, le raisonnement libéral, l’efficacité technique et la consommation, cohabite avec l’aspiration à retrouver la religion traditionnelle.
On aboutit ainsi à une réactivation qui s’explique également par l’échec des formes antérieures de modernisation …
En effet. L’occidentalisation à marche forcée, le développement, le nationalisme arabe, le panarabisme, le socialisme, tout cela a échoué. Que reste-t-il ? L’identité religieuse, la conscience collective ordonnée autour de l’acquis d’une tradition. Poussez ce mouvement de ressaisie jusqu’au bout, et vous avez le fondamentalisme, où il ne s’agit plus seulement de retrouver la religiosité coutumière, mais la vérité des origines détournée par la corruption du présent.
L’affaire-prétexte des caricatures de Mahomet a montré l’immense ressentiment de populations qui se sentent méprisées, laissées pour compte de l’histoire, en situation d’échec perpétuel par rapport à un Occident qui ne mesure pas combien la pénétration de ses façons de faire et de penser est destructrice pour les rapports sociaux en place, notamment dans cet islam qui, autant qu’une foi, est une règle de vie. L’Occident est aveugle sur les effets de cette mondialisation de l’économie et des moeurs, en termes de désagrégation de la famille traditionnelle, de changement violent dans le rapport entre hommes et femmes, entre générations. C’est d’un soulèvement existentiel qu’il s’agit.
Comment expliquez-vous cet « aveuglement » des Occidentaux ?
De la première guerre mondiale à la fin de la décolonisation, les Européens ont connu un moment de crise de leur bonne conscience de dominateurs. Ils ont essayé de comprendre ces autres cultures et civilisations qu’ils avaient si longtemps piétinées. Aujourd’hui, c’en est fini de cette remise en question. Ils sont globalement réconciliés avec leur histoire. Ils n’ont plus de prétention impériale, ils sont partisans de la coexistence pacifique des cultures, ils célèbrent la différence, mais ils ne s’intéressent pas beaucoup à ce qui n’est pas eux.
L’échec du projet de révolution socialiste et l’écroulement du bloc soviétique ont, en outre, imposé l’idée que la démocratie est un système indépassable et que le capitalisme de marché a fait ses preuves. Ce consensus sur le fonctionnement de nos sociétés ne pousse pas à la relativité du regard vis-à-vis du reste du monde. Il n’y a qu’une manière d’être moderne… Que ceux qui n’ont pas encore la chance de posséder la démocratie, la liberté d’expression, le marché, les droits de l’homme y passent d’urgence !
Pourquoi le ressentiment est-il plus vif qu’ailleurs en terre d’islam ?
Parce que la proximité fonctionne comme un facteur aggravant. C’est le troisième monothéisme, une religion qui se pense dans la suite du judaïsme et du christianisme et qui se veut comme le sceau de la Prophétie, la révélation ultime et définitive. Or aujourd’hui les fidèles du Prophète se trouvent, inexplicablement, dans une situation de vaincus, de dominés, et à plus d’un titre. Ils ont subi la colonisation. Le conflit israélo-palestinien est vécu comme le symbole de la perpétuation de cette humiliation coloniale. Par surcroît, ce développement à l’occidentale qu’ils subissent comme une agression ne marche pas.
C’est la différence avec des pays comme la Chine ou l’Inde. Le ressentiment nationaliste n’y est sûrement pas moindre, mais ces pays peuvent compter sur une cohésion collective et des structures politiques qui permettent de s’approprier avec succès, comme le Japon l’avait fait auparavant, la technique occidentale et le mode de raisonnement économique qui va avec. Il leur est possible de nourrir l’ambition de battre les Occidentaux sur leur propre terrain, tout en maîtrisant le processus et en restant eux-mêmes.
On ne trouve rien de pareil dans le monde arabo-musulman. Les Etats y sont à la fois faibles et tyranniques. Les outils de modernisation manquent. Dans ces conditions, on subit les dégâts d’une occidentalisation rampante sans en recueillir les bénéfices. L’impression de dépossession en est démultipliée. Comment ne pas voir l’incertitude profonde sur la solidité de sa religion qui anime la prétention de la mettre à l’abri de toute discussion ?
La liberté d’expression, dont l’Occident fait un absolu, doit-elle être limitée pour des motifs religieux ?
Non, ce serait hypocrite et inutile. L’Occident resterait ce qu’il est, nonobstant les limites qu’il ferait semblant de s’imposer. On ne peut pas plus demander aux musulmans de renoncer à ce qu’ils sont que demander aux Occidentaux de renoncer à leur bien le plus symbolique et le plus précieux : la liberté de pensée et d’expression.
Encadrer la liberté d’expression, légitimer des exceptions pour des motifs religieux serait une mauvaise réponse à une bonne question. Les gouvernements occidentaux ont d’abord à témoigner, par des actes tangibles, de leur capacité de prendre en compte la situation d’un monde islamique vis-à-vis duquel, il faut bien le dire, notre attitude se réduit à une indifférence globale, mâtinée de peurs ponctuelles. Précisément parce que nous sommes la civilisation de l’autocritique, nous avons à montrer que, si nous sommes ce que nous sommes, nous sommes aussi disposés à nous mettre à la place des autres. C’est une question de responsabilité politique à l’échelle de la conscience collective. Entre autres initiatives, une institutionnalisation européenne, conséquente et ouverte, de la connaissance de l’islam aurait valeur de signe exemplaire : nous sommes la terre de la connaissance critique – inutile de nous cacher derrière notre petit doigt -, mais dans ce cadre nous sommes prêts à faire droit à ce qui n’est pas nous.
N’êtes-vous pas frappé par la montée de la dérision qui vise toutes les religions ?
Oui. Il y a une nouveauté dans la dérision telle qu’elle est pratiquée depuis, disons, deux ou trois décennies en Europe. Elle illustre l’accélération de la « sortie » de la religion dont nous avons parlé. Nous sommes passés au-delà de la critique antireligieuse telle que nous l’avons connue autrefois. Celle-ci exprimait l’hostilité de principe à un système que l’on combat comme contraire à l’esprit de la liberté. L’opposition pouvait être très violente, mais elle supposait une sorte d’accord : vous, vous croyez à l’autorité de la révélation, nous, nous croyons à l’autonomie de la raison. Le dissensus était inexpiable, mais il y avait consensus implicite sur l’enjeu de l’affrontement – y compris dans le recours au ridicule qui tue.
Avec la dérision, on sort de cet accord implicite. Ce qui est récusé, c’est le terrain même où se situe la croyance. C’est ce qui la rend plus blessante pour une conscience religieuse que l’anticléricalisme ou l’athéisme traditionnels, qui pouvaient heurter, mais qui avaient une forte raison d’être. Avec la dérision, la conscience religieuse est malmenée dans ce qu’elle a de plus profond : le sentiment d’une certaine gravité de l’existence, le sens des interrogations ultimes devant la mort, l’au-delà, le salut. Ils sont bafoués par une superficialité satisfaite.
Le monde politique n’y échappe pas…
Non, bien sûr. Rien de ce qui est tenu pour sérieux n’est épargné. La dérision est devenue une sorte de critère de l’hyper-modernité. Sans doute faut-il y voir un réflexe d’enfant gâté pour sociétés de très haute prospérité. Elle est un épiphénomène idéologique poussant à la limite la foi libérale de nos sociétés : tout roule tout seul, alors pourquoi se poser des questions dramatiques ? La gravité n’est plus de saison… Il va de soi que plus on est engagé dans sa foi ou dans son action politique, plus ce refus du sérieux vous heurte de front. Alors que dire de la réaction dans des sociétés où la difficulté de l’existence conserve tout son poids…
La consigne du respect des croyances est-elle suffisante ?
Elle est à côté du sujet. Je crois même que l’expression est dangereuse. Elle confond deux choses. Ce que nous avons à respecter, ce sont les croyants. Mais autre chose est le droit intangible à l’irrespect pour les croyances, c’est-à-dire le droit de les soumettre à l’examen critique, comme tout système de pensée. Rien ne peut être soustrait à cet acide de la discussion publique. C’est la règle de notre monde. Vouloir lui assigner des limites est absurde. C’est se renier sans avoir la moindre chance d’aboutir.