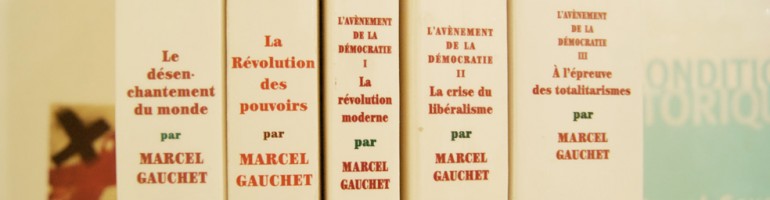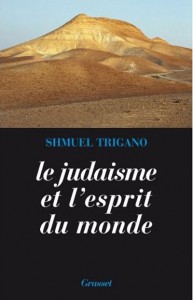Entretien vidéo avec le philosophe Marcel Gauchet, membre du Conseil d’orientation et de réflexion de l’assurance (CORA).
Rencontre avec Shmuel Trigano
À l’occasion de la publication de son ouvrage « Le Judaïsme et l’esprit du monde » (Grasset, 2011), le sociologue et philosophe Shmuel Trigano avait invité Marcel Gauchet à une conversation animée par l’historienne Perrine Simon-Nahum le jeudi 15 septembre 2011 au Musée d’art et d’histoire du judaïsme à Paris.
Akadem, le campus numérique juif, vient de mettre en ligne en accès libre l’enregistrement vidéo de cette rencontre.
Entretien avec Marcel Gauchet et Philippe Meirieu sur l’éducation
Article introductif de Nicolas Truong : Rentrée scolaire : les nouveaux défis
Dans quelle mesure l’évolution de nos sociétés ébranle-t-elle les conditions de possibilité de l’entreprise éducative ?
Marcel Gauchet : Nous sommes en proie à une erreur de diagnostic : on demande à l’école de résoudre par des moyens pédagogiques des problèmes civilisationnels résultant du mouvement même de nos sociétés, et on s’étonne qu’elle n’y parvienne pas… Quelles sont ces transformations collectives qui aujourd’hui posent à la tâche éducative des défis entièrement nouveaux ? Ils concernent au moins quatre fronts : les rapports entre la famille et l’école, le sens des savoirs, le statut de l’autorité, la place de l’école dans la société.
A priori, famille et école ont la même visée d’élever les enfants : la famille éduque, l’école instruit, disait-on jadis. En pratique, les choses sont devenues bien plus compliquées.
Aujourd’hui, la famille tend à se défausser sur l’école, censée à la fois éduquer et instruire. Jadis pilier de la collectivité, la famille s’est privatisée, elle repose désormais sur le rapport personnel et affectif entre des êtres à leur bénéfice intime exclusif. La tâche éducative est difficile à intégrer à ce cadre visant à l’épanouissement affectif des personnes.
Colloque conclusif de la Chaire Marcel Gauchet les 14 et 15 octobre 2011
Le Collège des Bernardins organisera un Colloque de clôture de la Chaire Marcel Gauchet en lien avec le département « Sociétés humaines et responsabilités éducatives », en partenariat avec l’Université du Québec à Montréal, le Centre Raymond Aron et le Groupe d’Étude de la modernité Anthropologique et Politique, les vendredi 14 et samedi 15 octobre 2011.
« Peut-on réinventer l’école ? », débat dans le cadre du Théâtre des Idées à Avignon
Tous les ans, en marge du festival d’Avignon, se tient le « Théâtre des Idées ». Cette série de sept débats et rencontres, faisant écho aux problématiques soulevées par la programmation du festival, est disponible en podcast.
En résonance avec l’actualité, marquée du sceau du désenchantement et de l’incivilité à l’école, Marcel Gauchet est invité, en compagnie du pédagogue Philippe Mérieu, à débattre sur le quatrième thème : « Peut-on réinventer l’école ? ».
Vous pouvez écouter ou télécharger l’émission (120 minutes) sur le site de Telerama-radio.
« Notre démocratie est en passe de devenir dérisoire »
(propos recueillis par Caroline Castets pour « Le nouvel Economiste »)
Un politique qui court après l’Histoire sans la comprendre, des sociétés trop effrayées pour se diagnostiquer, une démocratie devenue inopérante.
Observateur méticuleux des métamorphoses démocratiques – celles qui, au fil des ans et sans que l’on en ait conscience, ont radicalement modifié l’exercice du pouvoir, le rôle de l’Etat et les attendus des peuples à son égard sans pour autant modifier le cadre juridique originel – le philosophe et historien Marcel Gauchet fait l’inventaire implacable des bouleversements engendrés dans nos sociétés.
Entretien dans Le Point
(Propos recueillis par Saïd Mahrane)
Qu’en est-il aujourd’hui de la « démocratie », cette organisation du pouvoir que les Grecs inventèrent à Athènes au VIe siècle avant notre ère ? Le culte des élites ne nous condamne-t-il pas plutôt à l’oligarchie, ce pouvoir partagé par un groupe de quelques élus, jugés meilleurs, car hier plus robustes ou plus riches, mieux nés, ou aujourd’hui, soi-disant plus compétents ? Dans le nouvel opus du Point Références consacré à la sagesse grecque (sorti le 23 juin), le grand philosophe politique Marcel Gauchet donne son avis sur l’élite, et aussi sur la démocratie du troisième millénaire. Avec recul et anticonformisme, comme toujours.
Le Point : Depuis trente ans, l’élite est considérée comme le mal absolu. Vous-même, il vous est arrivé de dénoncer son influence néfaste…
Marcel Gauchet : L’élite est une très mauvaise notion. Au départ, quand elle a été formulée, au XIXe siècle, par des théoriciens italiens dits élitistes, tels Mosca et Pareto, cette notion se voulait réaliste et positive, et partait du constat que dans toutes les sociétés, le pouvoir est exercé par une minorité éclairée. Ces conceptions seront ensuite oubliées au profit de l’idée, d’origine marxiste, de couches et de classes dominantes, avec, sous-entendue, l’alliance de l’argent et de la compétence. Puis, à son tour, cette expression deviendra obsolète […] On a considéré, à partir des années 1970, qu’il existait un milieu transpartisan avec une connaissance du monde suffisante pour assumer les fonctions indispensables à l’adaptation du pays à la modernisation et à la mondialisation […] Les critères déterminants se situent du côté du capital éducatif et de l’insertion dans les circuits de décision. Même dans une société aussi tournée vers l’égalité des chances et le culte du self-made-man que les États-Unis, on assiste à l’émergence d’un véritable phénomène de caste en fonction des diplômes et des universités d’origine.
« L’école exige un contrat moral et social »
Dans un entretien pour la Vie (propos recueillis par Audrey Steeves), Marcel Gauchet s’explique sur l’objectif du séminaire qu’il tient au Collège des Bernardins sur l’éducation, « transmettre ou apprendre ? ». Il vise à analyser l’évolution de la vocation et des modalités de l’enseignement afin de mieux comprendre les enjeux – et le caractère problématique – de ce que l’on demande aujourd’hui à l’Ecole, au risque d’oublier sa fonction et ses limites premières.
Vous n’êtes pas croyant, pourquoi avoir accepté de présider cette Chaire du Collège des Bernardins ?
Marcel Gauchet. Ce dialogue avec l’Église n’est pas tout à fait une première pour moi, puisque j’avais déjà eu l’occasion de participer aux conférences de Carême, à l’invitation du cardinal Lustiger. Le contexte philosophique et social actuel exige cette discussion entre gens de foi et de raison. Car si la société est clivée, ce n’est évidemment plus entre laïcs et cléricaux, mais bien entre ceux qui se réclament d’une vision marchande et hédoniste de l’homme, et ceux, dont l’Église, qui croient en la vocation personnelle de chaque homme avec ce qu’elle comporte d’exigences culturelles et morales. Un nouvel humanisme dans le quel je m’inscris pleinement, et cette proposition des Bernardins m’est apparue comme un moyen de souligner cette convergence.
(…)
Que trouvez-vous de beau dans le fait de transmettre ?
Il serait naïf de penser que l’éducation rend l’humanité bonne, mais elle la rend sûrement meilleure. Et, chez beaucoup d’enseignants, il existe un grand sentiment de satisfaction à voir des personnes ouvrir leur esprit et comprendre des choses qu’elles ne comprenaient pas auparavant. C’est aussi une véritable responsabilité pour les enseignants. D’une façon plus personnelle, j’aime aussi le fait de contribuer à une aventure humaine dont personne n’a le dernier mot. Qu’il s’agisse de philosophie, d’art ou de mathématiques, l’enseignement crée de la continuité avec le passé, en montrant aux élèves qu’ils sont les dépositaires temporaires de quelque chose qui vient de loin et qui mérite d’être poursuivi. Il y a dans cette aventure humaine une forme de mystère qui donne du sens à la vie.
Les sciences du cerveau nous aident-elles à apprendre ?
Dans le cadre des conférences trimestrielles de sa chaire au Collège des Bernardins, Marcel Gauchet a organisé une soirée débat avec Lionel Naccache.
Intervenants :
Lionel Naccache, professeur de médecine à l’Université Pierre et Marie Curie, neurologue à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, chercheur en Neurosciences cognitives à l’Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière (ICM) à Paris. Il consacre ses travaux à l’exploration des propriétés psychologiques et cérébrales de la conscience. Son dernier livre : Perdons-nous connaissance ? : De la Mythologie à la Neurologie.
Répondants :
Jacques Arènes, psychanalyste, codirecteur du département « Sociétés humaines et responsabilités éducatives » du pôle de recherche du Collège des Bernardins, et maître de conférences Institut Catholique de Lille ;
Antoine Guggenheim, théologien, professeur et directeur du pôle de recherche au Collège des Bernardins.
Mais que cherche Marcel Gauchet au Collège des Bernardins ?
Depuis janvier 2010 jusqu’à décembre 2011, Marcel Gauchet préside la Chaire des Bernardins.
Quels sont les objectifs de cette invitation et quelle recherche anime-t-il au Collège ?
Le Collège a invité Marcel Gauchet pour un travail de recherche sur les fondamentaux de l’École et de l’enseignement.
Il a publié récemment plusieurs ouvrages sur ce sujet avec Marie-Claude Blais et Dominique Ottavi, qui sont le fruit d’un séminaire de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Nous avons pensé que sa recherche et son rayonnement personnel donneraient de l’assurance aux premiers pas de notre département « Sociétés humaines et responsabilité éducative ».