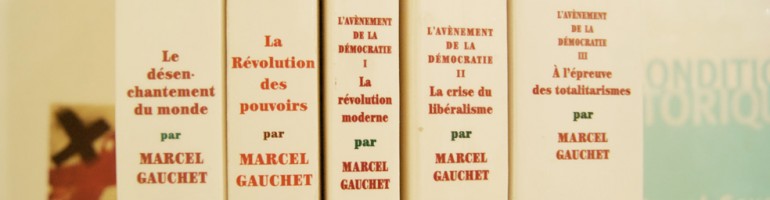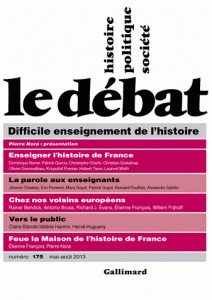Article de Marcel Gauchet publié sur marianne.net le 6 juillet 2013.
Un livre de Valérie Charolles, « Philosophie de l’écran », éclaire l’univers digital dans lequel nous vivons désormais. Le rédacteur en chef du « Débat » l’a lu pour nous.
Voici un puissant coup de projecteur sur la nouveauté si déconcertante de notre monde. Elle se résume dans un objet-fétiche, en permanence à portée de regard, compagnon de tous les instants : l’écran. Un objet carrefour en lequel confluent les chiffres de l’économie, les images qui nous informent, nous distraient, les messages qui nous bombardent.
Tout passe par lui : l’hégémonie des marchés, le règne des médias, l’omniprésence de la société du spectacle, la liberté des réseaux numériques. Ecran minuscule dans notre poche, écran géant à l’usage des foules, il est notre feu vital, le foyer autour duquel nous nous réunissons.
Derrière cet ustensile familier, il y a un nouveau monde que nous ne connaissons pas. Nous savons quels sont ses éléments, puisqu’ils ont été fabriqués de main d’homme et que nous en avons l’usage quotidien. Mais son fonctionnement nous échappe. N’en déplaise au principe qui voudrait que l’esprit saisisse comme vrai ce qu’il a fait, il nous est opaque et se soustrait à notre contrôle. Son émergence correspond au moment où, du point de vue de nos existences, l’univers artificiel l’a définitivement emporté sur le milieu naturel.
Nous sommes en train de vivre la fin de la nature, et les efforts que nous faisons pour la préserver ou la reconstituer ne font que l’artificialiser davantage. La moitié de la population du globe vit dans des villes, elles-mêmes de plus en plus techniques, organisées comme un assemblage de réseaux, de systèmes, de machines.
Qui travaille encore à transformer la matière de ses mains, comme à l’âge héroïque de la production ? Or voici qu’au moment où nous nous installons dans un « technocosme » conçu par l’intelligence humaine, ce milieu tissé de nos signes et de nos symboles, que nous devrions en principe maîtriser, nous devient obscur, énigmatique, étranger. La crise de l’action politique n’a pas d’autre motif. C’est le mystère de ce retournement que Valérie Charolles cherche à percer.
Continuer la lecture →
Archivé dans la catégorie :
Non classé