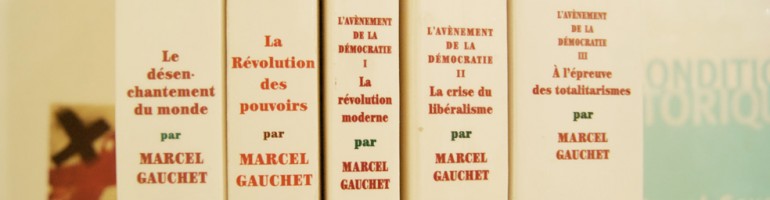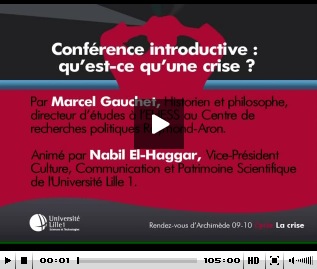Résumé des débats de l’Université d’été 2012 des Gracques. Ce groupe de réflexion, au départ des hauts fonctionnaires auxquels se sont joints des hommes d’entreprise et des intellectuels, qui se disent démocrates, libéraux, intégrateurs, progressistes, pro-européens, redistributeurs, écologistes, réalistes, défend une gauche modérée qui sache faire la synthèse entre les valeurs d’équité et l’acceptation de l’économie de marché. Au moment où François Hollande est confronté à ses premiers grands choix pour réduire la dette et redresser le pays, les Gracques ont tenu colloque, lors de leur université d’été, sur un thème particulièrement d’actualité : » La post-social-démocratie à l’épreuve du changement « . C’était le 30 juin au Théâtre de la Villette, à Paris.
Kemal Dervis, vice-président de Brookings Institution, président du Conseil international de Akbank, ancien directeur général du PNUD, ancien ministre turc de l’économie.
Marcel Gauchet, philosophe et historien, directeur d’études à EHESS, rédacteur en chef de la revue Le Débat.
Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères.
Animateur : Gilles de Margerie
Gilles de Margerie :
La nouvelle équipe gouvernementale a conscience des défis futurs (maîtrise de la dette, gestion de la crise), ce qui implique une capacité à redonner à la France un rôle moteur en Europe.
Le compromis qui caractérise la social-démocratie européenne ne s’est jamais ancré dans la pratique politique française : comment pouvons-nous en France inventer un tel projet ?
(Interruption par La Barbe, constatant 21 intervenants masculins sur 24. Les Gracques ont retenu le message. Gilles de Margerie a rappelé que pour la première fois, nous avons un gouvernement qui respecte la parité.)
Marcel Gauchet :
Nous sommes les héritiers de la social-démocratie. Si ses recettes ont perdu de leur pertinence, l’héritage de justice sociale conserve toute son actualité. Quels sont les moyens ou les instruments qui peuvent être les siens dans le monde actuel ?
Il est tout d’abord nécessaire de faire le bilan de la social-démocratie, en particulier de ses limites : celles-ci découlent des changements intervenus dans la géographie économique mondiale, les changements dans les systèmes productifs (économie de la connaissance) et dans la société (individualisation par opposition aux classes sociales). La social-démocratie est-elle un socle incontestable ? Le modèle européen est-il encore pertinent ? Celui-ci semble historiquement dépassé puisque l’Europe est en train de s’aligner sur un programme libéral. Cette vision enferme les sociaux-démocrates dans une stratégie défensive. La gauche social-démocrate doit retrouver une audience sur fond d’un grand scepticisme. C’est à cette difficulté que va se trouver confronté, entre autres, le nouveau gouvernement français.
Répondre à ces défis suppose de reformuler un projet social-démocrate adapté au monde dans lequel nous vivons. Il doit reposer sur une gestion rigoureuse mais surtout sur une capacité de proposition.
La rupture sarkozyste constitue un antimodèle. L’échec de la stratégie de réforme sarkozyste est notable. Ainsi, la négociation avec des partenaires sociaux fantomatiques, car peu représentatifs, ne mènera à rien. La Gauche, en tant qu’héritière des Lumières, doit reprendre l’initiative. L’exigence de justice constitue une de ses composantes principales. C’est elle qui lui donnera la capacité de faire adhérer les populations à un projet raisonnable.
Le régime de technocratie bienveillante, ne prenant pas en compte les populations, est à bout de souffle. La décennie passée a consacré le vide doctrinal des gauches sociale-démocrates face à l’évolution de l’idéologie libérale. La crise a bouleversé cet ordre. La pensée sociale-démocrate peut reprendre l’initiative, par l’audace intellectuelle et la discussion sans sectarisme. Il faudra trouver la bonne grille de compréhension pour rendre intelligible la crise.
L’Etat incarne la sacro-sainte notion de service public, à laquelle il faut donner un contenu. Il faudra pour cela rendre les services publics plus efficaces, par opposition à la politique du moindre coût. Il s’agit de préserver la qualité future de l’hôpital public, pour lequel les Français ont le sentiment d’une dégradation progressive. Il s’agit également de la scolarisation de la petite enfance. Celle-ci ne se réduit pas au problème de garderie des enfants pour favoriser l’activité des femmes, mais constitue aussi une question de justice sociale. La notion de Travail doit être entièrement repensée. Certaines notions ont fait la preuve de leur nocivité : « travail non qualifié », « société post-industrielle ». L’exemple de l’Allemagne montre que ces notions, en plus d’être dégradantes pour les individus, n’ont aucun sens. Il apparaît indispensable que la social-démocratie remette le travail au centre de la société et restaure la dignité des personnes.
Continuer la lecture →