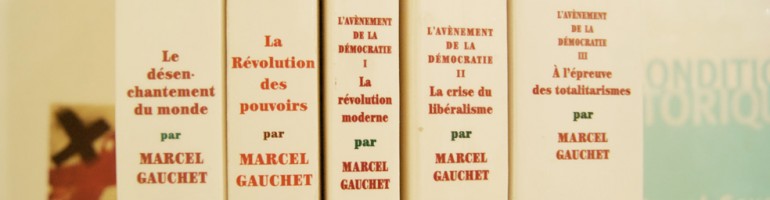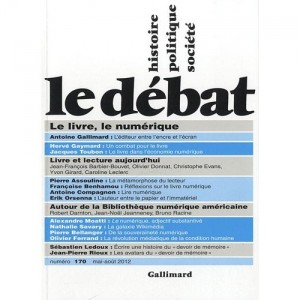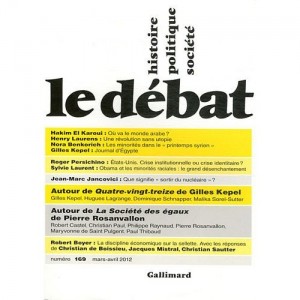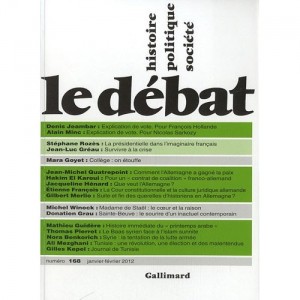Propos recueillis par Sylvie Pierre-Brossolette pour le Point.
À l’heure où la gauche retrouve le pouvoir en France, la crise ébranle les économies européennes. Pour les Gracques, ce cercle de réflexion qui rassemble des personnalités de la gauche modérée et organisent leur université d’été le 30 juin, le moment est stratégique pour réconcilier socialisme et économie de marché.
Pour tout savoir de l’université d’été des Gracques, rendez-vous sur www.lesgracques.fr
Le Point.fr ouvre le débat en donnant la parole à Marcel Gauchet et Sigmar Gabriel, le président du SPD.
Marcel Gauchet : « Redéfinir l’État-providence »
Le Point : Le modèle social-démocrate est-il adapté aux exigences de la mondialisation ?
Marcel Gauchet : Dans sa forme classique, sûrement pas. Mais cela ne veut pas dire que ce modèle n’est pas capable de s’adapter à la situation nouvelle. D’ailleurs, les pays qui étaient des exemples en la matière, les pays du nord de l’Europe, ont montré qu’ils savaient évoluer. L’idéal d’approfondissement de la démocratie en vue de l’accroissement de la justice sociale conserve toute sa pertinence. Ce sont les moyens d’aller vers cet idéal qui sont à repenser. Nous ne sommes plus à l’heure du compromis de classes assuré par une négociation sociale institutionnalisée entre syndicats et patronats sous l’égide d’un État contrôlant la bonne marche de l’économie. Une économie d’innovation mondialisée impose d’autres contraintes. La société a profondément changé, le rôle de l’État aussi. Mais il s’agit plus que jamais de protéger les individus contre les fluctuations accélérées de la vie économique, de les aider à s’y insérer, de limiter les effets inégalitaires de la nouvelle dynamique du capitalisme. Plus la mondialisation impose sa loi, plus le besoin de correction sociale et de réponse démocratique augmente. Il n’y a pas un modèle social-démocrate immuable. Il y a une idée de ce que doit être une société démocratique mieux vivable pour ses membres qu’il s’agit de faire évoluer en fonction des transformations du système de production des richesses.
Quelle souveraineté peut encore exercer un gouvernement de gauche sur le plan économique et social ?
Le mot de « souveraineté » est trompeur parce qu’il évoque une position de commandement qui ne s’est jamais bien appliquée au domaine économique dans le monde démocratique. Il ne s’agit pas de régenter la vie économique et sociale, il s’agit d’influer sur elle pour que ses résultats soient les plus favorables possible pour le bien-être collectif. Personne ne conteste, par exemple, le rôle déterminant des États dans « l’attractivité des territoires », grâce à la qualité des infrastructures, à la qualification de la main-d’oeuvre, à la sécurité juridique, etc. Dans la mondialisation, les États commandent moins à l’intérieur, mais ils ont à être stratèges vis-à-vis de l’extérieur. C’est là que sont les marges de manoeuvre pour un gouvernement qui s’en donne les moyens. Notre problème en la matière, c’est l’Europe, qui n’a aucune stratégie d’ensemble et qui a inhibé les capacités des États membres, en tout cas de la France. Ce sont les entreprises qui remplissent cette fonction, sauf que leur problème n’est pas l’intérêt collectif. C’est sur ce terrain qu’un gouvernement de gauche a à faire montre d’imagination.
Comment définiriez-vous la gauche française ?